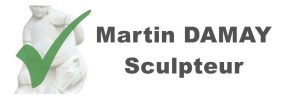La sculpture et la beauté
Table des matières
ToggleIl faut réapprendre à dépasser l’aura du sujet développé dans une forme, pour apprécier la véritable beauté qui en ressort.
Qu’est- ce que la beauté et comment la définir ?
Sculpture pérenne et beauté durable
Le réseau social que je consulte décrète ce qu’est la beauté ; ce procédé d’opinion par le « like » est funeste pour la sculpture et l’Art.
La sculpture comme la beauté ont leurs fondements
De toutes mes années de pratique, il semble que la sculpture rejoint la beauté lorsqu’il y a maitrise sur la matière.
La laideur vient, à l’inverse, d’une faiblesse de l’acte sculptant.
La beauté n’est pas dans le mythe « Pygmalion et Galatée ».
Si la laideur se trouve dans la déshumanisation exhibée sur un tableau ou une statue, approfondissons la lecture de l’œuvre.
La sculpture est un soulèvement de la terre
Sculpter la pierre, c’est la soulever, révéler ce que la matière peut porter en elle.
Chaque coup de ciseau soulève la poussière et imprime une forme. La terre elle-même s’élève pour donner naissance à une présence intemporelle.
Dans ce dialogue entre la main et la pierre, naissent des œuvres ancrées dans la tradition.

La beauté ne s’associe pas à limite, et elle est nécessaire à toute avancée et progrès, c’est à dire pour la création et l’invention.
Mais dans la sculpture se trouve un drame : le sujet fixé dans son mouvement.
La sculpture est écoute
La beauté dans la sculpture n’est pas une idée abstraite, inintéressante ou réduisante, absente de la vie, mais elle contient des exigences propres du fait de la matérialité de la sculpture.
Les plans construits, les lignes placées, les profils clairs, définissent la sculpture.
L’incarnation possède la même réalité tri-dimensionnelle.
La beauté ne m’échappera pas si dans les premiers instants de mon geste de sculpteur :
- je la capte
- je l’écoute
- je lui offre le plan qui se sculpte et la ligne à construire.
La sculpture sur pierre est quête de beauté
La beauté fait partie de la quête de la sculpture et elle a sa part dans la qualité de celle- ci.
Si ma sculpture est belle, elle est réussie, et si ma sculpture est réussie, c’est qu’elle contient une part de beauté indépendamment du sujet développé.
Je ne la cherche pas en elle même, j’utilise :
- des médiateurs
- des techniques
Une œuvre structurée n’est pas laide.
La sculpture est construite et structurée.
La sculpture est une beauté vivante dans une matière immobile
Admettre la sculpture comme beauté immobile n’est pas une réduction de celle- ci : L’acte « d’incarnation » qui définit l’attitude d’un acteur de cinéma, a lieu dans le processus de sculpture.
Mais alors que le cinéma est basé sur la relation sociale, souvent conflictuelle, la statue a son potentiel dans une autre forme de socialité, de l’ordre de l’individu.
La beauté de l'œuvre d'art est troublée par la puissance du sujet
Dans l’article « Sculpture et art sacré» j’étudie la beauté en tension :
Nous nommons « beauté » ce qui est une forme de soumission à la force du sujet : Une oeuvre d’art religieuse contient intrinsèquement le «beau».
Mais sa valeur artistique peut néanmoins paradoxalement se réduire à peu de chose : l’œuvre devient alors en tension entre la puissance de la beauté-sujet et l’exigence technique ou artistique au sens pur.
« C’est affreux mon Dieu ! »
La paradoxe de la beauté en la statue Notre-Dame de Paris
La statue de la Vierge « Notre-Dame de Paris » incarne une beauté paradoxale, où le sujet sacré se confronte aux imperfections de sa réalisation :
- Avec sa couronne démesurée
- son étoffe ressemblant à une chasuble de chanoine qui semble cacher un corps sans formes
- son lys transformé en bougeoir
- ses yeux gonflés, cette sculpture rompt avec les canons de la beauté gothique de l’époque.
L’Enfant Jésus, droit et raide, accentue encore l’inharmonie.
Cette statue, expressioniste, trouve la beauté dans la force de son sujet et l’aura qu’elle dégage, malgré ses défauts esthétiques évidents. Elle reste un exemple de dévotion et de symbolisme plus que de perfection artistique et sculpturale dans le domaine de la Vierge à l’enfant.
Nous croyons que la beauté d’une sculpture provient d’une orchestration, d’une architecture.
Le travail est exigeant car au cours de la fabrication, au cours de la sculpture, la matière tend à influencer l’acte.
Mais la sculpture qui en résulte, qui contient en soit différentes formes :
– une main
– un cou
– un drapé recouvrant un corps…
Ceux- ci ne peuvent en aucun cas être sculptés comme symboles.
Les formes ne peuvent en aucun cas être sculptées comme symboles.
Conclusion
Il faudrait apprendre ou réapprendre à dépasser la force du sujet représenté et son aura, pour apprécier dans un jugement simple le degré de beauté véritable qui peut lui être attribué.